À paraître
 Serena Galasso
Serena Galasso Le droit de compter. Les livres de gestion et de mémoires des femmes (Florence, XVe-XVe siècles)
Cet ouvrage vient cependant nuancer cette interprétation grâce à la découverte et à l’analyse d’une documentation jusqu’à présent totalement inexplorée : les livres de gestion et de ricordanze tenus par/pour les femmes du patriciat marchand.
Pendant leur vie matrimoniale et, plus souvent, pendant leur veuvage, les Florentines de l’élite urbaine pouvaient ouvrir des livres privés pour administrer des biens familiaux, surveiller des richesses personnelles et consigner tous les actes utiles à leur gestion. Par le biais de l’écrit, elles négociaient leurs capacités de gestion et leurs rôles au sein de la parenté, protégeaient leurs intérêts en déjouant les normes de la succession patrilinéaire et contribuaient activement à la production de la mémoire familiale.
L’analyse minutieuse de près de 200 livres de comptes révèle ainsi que cette pratique d’enregistrement et de mémoire n’était pas un monopole masculin et permet de renouveler l’historiographie sur les rapports de genre dans les sociétés médiévales et de la Renaissance.
Serena Galasso, docteure en histoire médiévale auprès de l’École des hautes études en sciences sociales, est actuellement chercheuse postdoctorale à l’université de Padoue. Ses recherches portent principalement sur les rapports de genre, les pratiques d’écriture et la culture matérielle des sociétés de la fin du Moyen Âge.
Collection de l'École française de Rome 618
Rome: École française de Rome, 2024
576 p., ill. n/b et coul.
ISBN: 978-2-7283-1609-0
Prix: €
État: À paraître
 Christian Mazet, Paolo Tomassini
Christian Mazet, Paolo Tomassini Un musée pour l’École. La collection d’antiques de l’École française de Rome
Hors collection
Rome: École française de Rome, 2024
200 p., ill. coul.
ISBN: 978-2-7283-1807-0
Prix: €
État: À paraître
 Christophe Chandezon, Bruno D'Andrea, Armelle Gardeisen (dir.)
Christophe Chandezon, Bruno D'Andrea, Armelle Gardeisen (dir.) Circulations animales et zoogéographie en Méditerranée (Xe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.)
Collection de l'École française de Rome 622
Rome: École française de Rome, 2024
688 p., ill. couleurs
ISBN: 978-2-7283-1808-7
Prix: € 42
État: À paraître
 Julia Castiglione
Julia Castiglione L’œil expert. Juger la peinture dans la Rome moderne (1580-1630)
Collection de l'École française de Rome 621
Rome: École française de Rome, 2024
352 p., ill. coul. et n/b
ISBN: 978-2-7283-1664-9
Prix: €
État: À paraître
 Dominique Rivière, et alii (dir.)
Dominique Rivière, et alii (dir.) Les métropoles d’Europe du Sud à l’épreuve des crises du XXIe siècle
Par une approche comparative et pluriscalaire, cet ouvrage propose une grille de lecture innovante des métropoles d’Europe du Sud comme observatoire privilégié de l’adaptation aux crises contemporaines. À travers de nombreuses études de cas portant sur des territoires variés (Athènes, Rome, Naples, Milan, Barcelone, Madrid, Valence, Catane …), il offre un point de vue utile pour aborder la notion de crise et les grandes thématiques contemporaines : politiques de régénération urbaine et culturelle, action publique et mobilisations citoyennes, logement et économie des plateformes touristiques, innovation sociale et vulnérabilité urbaines, migrations et accueil.
Une synthèse richement illustrée qui vient contribuer au débat plus général sur les métropoles et le processus de métropolisation.
Collection de l'École française de Rome 619
Rome: École française de Rome, 2024
368 p., ill. coul. et n/b
ISBN: 978-2-7283-1810-0
Prix: € 32
État: À paraître
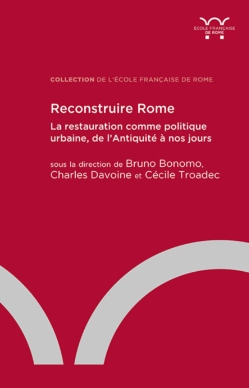 Bruno Bonomo, Charles Davoine, Cécile Troadec (dir.)
Bruno Bonomo, Charles Davoine, Cécile Troadec (dir.) Reconstruire Rome. La restauration comme politique urbaine, de l’Antiquité à nos jours
Partout dans Rome, les monuments sont couverts d’inscriptions, antiques ou modernes, qui ne rapportent pas uniquement le nom de leur constructeur, mais célèbrent leur restauration. Les empereurs romains, les dirigeants de la Commune au XIIe siècle, les papes de la Renaissance ou encore Mussolini au XXe siècle se sont souvent présentés comme les protecteurs d’un patrimoine ancien et ont fait de la restauration urbaine l’un des fondements de leur légitimité, quand bien même ils modernisaient la ville. En effet, toute l’histoire de l’urbanisme romain peut être interrogée sous l’angle du lien qui unit reconstruction matérielle de la ville, identité romaine et restauration d’un ordre politique.
Cet ouvrage collectif réunit seize contributions d’historiennes et historiens, archéologues, spécialistes de la littérature latine et historiennes et historiens de l’art, qui mettent en lumière l’impératif politique de la restauration à différentes époques et différentes échelles, du monument ou du quartier à l’espace urbain dans son ensemble. De l’Antiquité aux premières années du XXIe siècle, les notions de restauration ou de reconstruction se révèlent alors à la fois comme un moteur de l’urbanisme romain, un programme politique des pouvoirs publics et un idéal partagé ou contesté par les différents acteurs de la ville.
Collection de l'École française de Rome 616
Rome: École française de Rome, 2024
520 p., ill. coul. et n/b
ISBN: 978-2-7283- 1813-1
Prix: € 36
État: À paraître


