|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Novità editoriali
| Antichità | Medioevo | Epoca moderna e contemporanea | Tutte le novità | In corso di stampa |
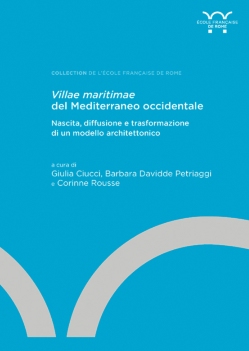 Giulia Ciucci, Barbara Davidde Petriaggi, Corinne Rousse (a cura di)
Giulia Ciucci, Barbara Davidde Petriaggi, Corinne Rousse (a cura di) Villae maritimae del Mediterraneo occidentale : nascita, diffusione e trasformazione di un modello architettonico
A partire dalla fine del II sec. a.C., la villa maritima, lussuosa residenza destinata alle alte sfere dell’aristocrazia romana, caratterizza le coste dell’Italia centrale per poi diffondersi, in epoca imperiale, in tutto il bacino del Mediterraneo. Nonostante gli studi e le ricerche dedicati a questo tema, non esiste una definizione chiara e univoca in grado di descrivere le peculiarità del modello architettonico della villa maritima e le trasformazioni che esso subisce con la sua diffusione al di fuori dall’Italia. Solo grazie alle evidenze archeologiche, numerose in tutto il Mediterraneo, è possibile definire alcuni elementi rappresentativi della villa maritima e seguirne le trasformazioni, a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C., in nuove forme di abitato rurale, quali il palazzo, la chiesa o il monastero.
Questo volume è il frutto delle giornate di studio tenutesi a Napoli, Capri e Baia nel maggio 2019. I vari esempi di ville marittime qui presentati testimoniano lo stato attuale della ricerca e contribuiscono a rilanciare il dibattito su temi centrali quali la diffusione del modello architettonico e del suo linguaggio nel Mediterraneo, le molteplici funzioni e trasformazioni delle villae maritimae, la loro conservazione, tutela e valorizzazione.
Questo volume è il frutto delle giornate di studio tenutesi a Napoli, Capri e Baia nel maggio 2019. I vari esempi di ville marittime qui presentati testimoniano lo stato attuale della ricerca e contribuiscono a rilanciare il dibattito su temi centrali quali la diffusione del modello architettonico e del suo linguaggio nel Mediterraneo, le molteplici funzioni e trasformazioni delle villae maritimae, la loro conservazione, tutela e valorizzazione.
Giulia Ciucci è responsabile del sito archeologico di Saint-Romain-en-Gal, dottore di Ricerca (PhD) e specialista di architettura romana.
Barbara Davidde Petriaggi è direttrice del Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea dell’Istituto Centrale per il Restauro del Ministero del Cultura e professore a contratto di Archeologia Subacquea all’Università degli Studi Roma Tre.
Corinne Rousse è professore ordinario di archeologia romana all’università di Aix Marseille, vice direttrice del Centre Camille Jullian UMR 7299, già membro dell’École française de Rome e specialista di archeologia litorale.
Collection de l'École française de Rome 614
Rome: École française de Rome, 2024
354 p., ill. coul.
ISBN: 978-2-7283-1613-7
Prezzo: € 62

Versione on line OpenEdition Books
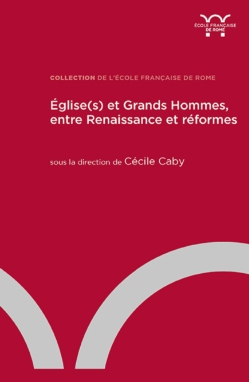 Cécile Caby (a cura di)
Cécile Caby (a cura di) Église(s) et Grands Hommes, entre Renaissance et réformes
Loin de se cantonner aux portraits des princes et des rois, des hommes de guerre ou des lettrés et artistes laïcs, la représentation en série des hommes illustres aux XIVe-XVIIe siècles pénètre aussi au coeur de l’institution ecclésiale : d’une part les catalogues d’hommes illustres englobent des papes, évêques, frères et autres clercs ; d’autre part, l’Église romaine ou certains groupes en son sein – comme les ordres religieux –, puis les différentes Églises réformées captent à leur profit les potentialités de cette nouvelle forme d’écriture biographique et historique, déployée dans toutes les déclinaisons de la rhétorique eulogique. En s’interrogeant sur les renouvellements de la biographie religieuse entre Renaissance et réformes, ce livre entend ouvrir deux pistes d’analyse, trop souvent oubliées dans l’historiographie : l’une relative à l’évolution des formes de représentation des mondes ecclésiaux et de leur histoire ; l’autre attentive à la promotion des nouvelles pratiques culturelles humanistes au service de la construction et de la promotion des identités religieuses, notamment sur fond de conflits entre l’Église romaine et les nouvelles Églises issues des réformes protestantes.
Cécile Caby est professeure en histoire du Moyen Âge à Sorbonne Université. Elle est spécialiste des ordres religieux dans l’Italie de la fin du Moyen Âge et de l’histoire de la culture humaniste.
Collection de l'École française de Rome 620
Rome: École française de Rome, 2024
352 p., ill. coul. et n/b
ISBN: 978-2-7283-1661-8
Prezzo: € 32

Versione on line TORROSSA Versione on line OpenEdition Books
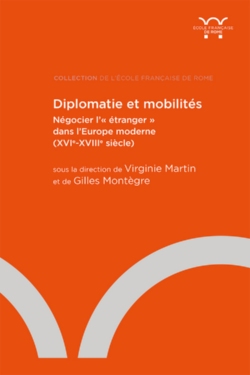 Virginie Martin, Gilles Montègre (a cura di)
Virginie Martin, Gilles Montègre (a cura di) Diplomatie et mobilités. Négocier l’« étranger » dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècle)
Depuis la première modernité jusqu’à l’âge des révolutions, la mobilité des étrangers constitue un véritable enjeu diplomatique en Europe. Dans cet ouvrage, les auteurs questionnent le périmètre, les ressorts et les effets de l’action et de la protection diplomatiques sur les dynamiques de cette mobilité et la fabrique de l’étranger. Comment les diplomates contribuent-ils à impulser, encadrer ou entraver ces mobilités, subies ou choisies ? Dans quelle mesure participent-ils de l’intégration ou de la marginalisation d’individus et de communautés, qualifiés d’« étrangers » du fait de leur origine ou de leur sujétion à autrui ? En quoi tendent-ils ainsi à façonner autant qu’à brouiller l’identité, toujours incertaine, de ces étrangers ?
Autant de questions qui ouvrent la voie à une relecture critique du concept de soft power, mettant en lumière la portée politique de la négociation diplomatique des personnes et des biens culturels. Les ambassadeurs, rouages essentiels du marché des arts, des savoirs et des savoir-faire, se conduisent en entrepreneurs et en protecteurs de mobilités culturelles. Ce faisant, le traitement diplomatique de la personne (physique et juridique) de l’étranger et de ses biens infléchit, voire cisèle, la condition d’extranéité. Cet ouvrage, en privilégiant une diplomatie au ras du sol et au fil de l’archive, envisage ainsi de manière conjointe action diplomatique, échanges culturels et construction de l’altérité.
Virginie Martin est maîtresse de conférences en histoire moderne à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne.
Gilles Montègre est maître de conférences HDR en histoire moderne à l’université Grenoble Alpes.


